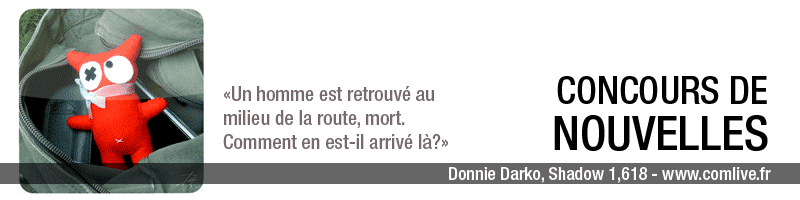L’homme sur la route
Il
devait être 23h20 passé quand l’inspecteur MacCalloway arriva sur les lieux. Je
m’en souviens car mon café était complètement froid, avec ce chien de temps, et
le goût de pluie qu’il avait prit n’était pas non plus pour me plaire. Et d’ailleurs,
j’étais de mauvaise humeur. Quelle idée a-t-on de réveiller les gens à une
heure pareille! Et pour un vulgaire ivrogne renversé en plus. Bref, sur le
bord de cette petite nationale campagnarde, sous cette pluie battante, avec la
sirène de notre voiture de service hurlant dans la nuit, cette histoire commençait
mal. Mais l’inspecteur était là maintenant, et cet inconnu aussi y était bien,
et lui ne risquait plus d’avoir froid ou de se sentir trempé. Je ne sais pas si
vous avez déjà vu un clebard écrasé en plein milieu de la route, qui s’est déjà
fait passé dessus plusieurs fois, mais là c’était pareil. On ne peut pas blâmer
les automobilistes, avec la nuit noire, en plein hiver, on ne se rend compte de
rien, et le brouillard de ce soir on ne voit pas à cinq mètres. Ils ne se sont
rendus compte de la présence du bonhomme qu’au moment où les roues de leur véhicule
passait sur ces os et cette chair broyée. Avec les sales histoires qu’on
raconte ici, personne ne serait assez fou pour s’arrêter et vérifier si c’était
les restes d’un biche... ou d’autre chose. C’est la raison pour laquelle nous
fûmes assez étonnés que quelqu’un ait malgré tout signalé le cadavre. Au
centrale, ils ont dis qu’on ne pouvais pas laisser l’affaire en suspens jusqu’au
lendemain, au moins par respect pour cet homme qui avait pris la peine d’appeler.
Et
me voila, moi, Robert «gunny bunny» Herbert, avec mon chef - que j’appelle «manitou»,
car il a toujours réponse à tout - auprès de cette charogne puant l’alcool, à mille
milles lieux de toute terre habitée, comme disais l’autre. Il est pas beau à voir.
Même si sa mort ne date pas d’il y a plus de douze heure, selon le patron, il
empeste quand même, à la fois la vieille viande et la mauvaise gnôle. C’était
manifestement un vagabond, son velours encore plus troué que rapiécé, sa veste
de grosse toile, ses épaves godillots, et son chapeau melon trop petit en
attestent. Evidement, pas un papier pour nous simplifier la tâche, pas un
billet de train ou de bus qui puisse nous indiquer ses derniers déplacements. En
plus, le corps rongé par l’alcool depuis des années, et achevés par les pneus,
ne nous révélera pas grand chose. Dans la triste et violente Lost-paradise
city, les zombies alcooliques comme lui hantent les rues dès l’heure de
fermeture des bars, dorment sous les ponts, se réchauffent près de braseros. Si
on prenait pitié d’eux, si on leur jetait simplement un coup d’oeil, on ne
pourrais plus dormir la conscience en paix, alors on les oublie, même si nos
charognes finissent toujours par puer autant que les leurs. Mais le devoir impérieux
nous impose de retrouver ses proches, si sa famille n’a pas simplement oublié son
existence, et des les informer du triste événement, à l’occasion de leur
demander d’identifier le corps. Si personne ne peut payer un enterrement, ça
sera la fosse commune pour lui.
L’automobiliste qui a prévenu le
central est un peu bousculé, pensez donc. Cette face de cauchemar écrasée
contre la chaussée, ce corps en charpie, cette odeur infecte, c’est le genre de
choses qui vous fait lever la nuit pendant des mois, quand on est pas habitué. Faut
voir la tronche de notre vivant, on dirais presque qu’il est déjà passé de l’autre
coté. On l’invite donc à boire un coup dans le pub le plus proche, à quelques
miles de là, c’est de cet endroit qu’il a appelé. Pour le coup, il
reprend des couleurs, et nous, on prend sa déposition. Il décide finalement, à
sa septième chopine, qu’il est maintenant absolument sûr de sa version des
faits. Je remballe mon petit carnet, le chef se grille une clope, et on sort,
le laissant avachi sur cette table, dans ce sinistre pub enfumé, avec la note
pour lui. Ca sera bien une chance s’il se souvient de quoi que ce soit en se réveillant.
Mais l’affaire sera coton, on a pas la moindre information sur notre macchabé. On
devra certainement écumer les bars et les bas-quartiers. On décide de toute façon
que ce ne sera pas ce soir, on reprendra demain. Le patron me ramène devant
chez moi, et repart seul dans la nuit.
***
Le réveil a été dur, c’est
tout ce que je peux dire. Quand j’arrive au central, Cathryn m’accueille avec
son habituelle indifférence. C’est encore elle qui a tout fermé hier soir,
quand on est parti, et c’est aussi elle qui a ouvert ce matin, me dit-elle. Puis
elle ajoute qu’elle n’est pas payé pour ça. Non, c’est évident. Elle, c’est le
pot de fleur qui fait les comptes. Elle décore agréablement ce minable
appartement transformé en QG de «Calloway&Herbert associated», comme
inscris sur la plaque à la porte. En fait d’association, c’est plutôt un
esclavage. Je suis toujours payé au lance-pierre à la fin d’une affaire, si
encore le patron n’a pas dû tout donner à notre logeur, qui râle sans cesse des
retard de paiements. Il faut dire qu’avec deux ou trois affaire par mois, on s’en
sort difficilement, d’autant que ce sont toujours des histoires de cocus qui
veulent prouver l’infidélité de leur conjoint. Le patron a sa stratégie bien
rodée. Si c’est une femme qui se présente, il tente de la réconforter d’abord,
et quelques temps après, il sort de ses stocks de photos prises sur le fait - mais
où on ne voit jamais le visage - celle qui servira de preuve. Il en profite
alors pour caser une proposition de mariage, immanquablement rejetée. Si c’est
un homme qui vient se plaindre, il contacte la femme, et lui propose de la
couvrir si elle accepte de sortir avec lui. Si elle refuse, il sort au mari une
de ses «preuves» prise dans son fameux tiroir à preuves. J’admire mon chef.
Cathryn s’est chargée d’appeler
l’hôpital hier soir, ils auront envoyer une équipe pour ramasser notre homme étendu
sur la route. Quand on arrive à la morgue, le légiste a déjà fini son
charcutage. Indéniablement, l’homme était un alcoolique invétéré, et si sa vie
ne s’était pas brusquement terminé sur cette route, il est certain que son foie
n’aurait plus tenu très longtemps. C’est du moins ce qu’il a pu apprendre des
restes de l’abdomen de l’inconnu. Il n’a pas pu nous donner beaucoup de précisions
sur le moment de la mort, ni sur le nombre de voiture qui lui sont passées
dessus. Alors que nous prenons le chemin de la sortie, il rajoute à la sauvette:
«Mais je ne m’explique toujours pas les coups derrière la tête». Et c’est
maintenant qu’il nous dit ça! Nous revenons vers lui, et lui demandons ce qu’il
veut dire. Manifestement, l’individu a pu recevoir une série de coups mortels,
antérieurs à l’accident. Ce n’est qu’une supposition, dit-il, car l’alcool qui
imprégnait la moindre parcelle de son corps empêche une interprétation claire. D’autant
que les roches en bordure de la route auraient très bien pu causer ces
blessures, si sa tête les avait heurté au moment de la chute. Ce qui semblait n’être
qu’un vulgaire fait divers vient de s’étoffer dramatiquement. Dramatiquement,
car il n’y aura certainement personne pour nous payer, quel que soit l’aboutissement
de l’affaire.
Le chef contacte la police, qui nous avait délégué cette
histoire pour ne pas avoir à se déplacer à une heure aussi tardive, et les
informes des conclusions et des doutes du légiste.
On lui dit de venir sur
place. On prend sa vieille Ford, qui malgré son âge et les divers détonations
inquiétantes et fumées opaques qu’elle émet se tiens encore très bien. On est
accueilli au commissariat par l’inspecteur en chef Stanley Kurt, inséparable de
ses beignets. Je n’ai jamais su ce qui me dégoûtait le plus chez lui: l’odeur
de tabac froid qui émane de lui en permanence, ou les tâches de graisses qui
mouchettent son costume. Il nous entraîne dans son bureau, sans prendre la
peine de nous remercier d’avoir fait le sale boulot pour lui et ses gars. Il
cale son gros derrière entre les accoudoirs de son siège miteux et nous invite à
tout raconter. Pour lui, l’affaire est claire: un pochtron complètement cuité se
perd dans la nuit, aidé par l’alcool, une voiture le percute fortuitement alors
qu’il est caché par le brouillard, et sa tête cogne le sol, provoquant ces
marques. Il ponctue son discours par les crissements désespérés de son siège, écrasé
par la masse de ce postérieur pachydermique. Il se relève, et nous chasse de
son bureau en s’essuyant le front, nous hurlant au travers de la porte de «notifier
aux personnes concernés le tragique décès». Quel porc agréable, ce commissaire.
Nous voila acculés à ce
que nous appréhendions depuis le début de faire: écumer les bas-quartiers pour
retrouver sa trace, et ses proches. Mais on ne se promène jamais là-bas sans
rien, c’est un principe de précaution de base. On fait un tour au central, le
chef attrape un petit Smith et Wesson qui traînait là, ainsi qu’un schlass. On
passe ensuite chez moi, pour que je récupère mon matos. Aujourd’hui, pas de
raison de prendre l’artillerie lourde, le Colt 45 restera donc au coffre, et
je me choisis un petit semi-automatique de défense, que j’accompagne d’une
matraque souple. Avec ce qu’on a pris, on devrait être en mesure de faire face à
toutes les situations qui se présenteront aujourd’hui puisqu’il fait jour, la
canaille ne sortant qu’à la nuit tombée. On traverse donc Little Italy et ses
mafias, le ghetto où la peau des hommes est de la couleur des fumées qui
sortent des usines où ils travaillent, et le quartier de Green Hill, avec ses
grosses demeures luxueuses et ses voitures reluisantes. Nous voila arrivés à la
rivière de boue, la Mud River, où se regroupe toute la vermine de la ville, des
putes aux assassins en cavale, des poivrots aux marginaux.
Dans ce quartiers, les
flics ne s’aventurent jamais, l’uniforme y est mal vu. Mais comme il y a de
nombreux prestataires de services assez spéciaux, et des commerçants de choses
pas très légales mais qui intéressent les riches oisifs et curieux, nous
devrions pouvoir nous faufiler sans être arrêtés par les autochtones. On doit
en premier essayer de savoir qui était cette personne, et qui étaient ses
proches. A priori, les gens comme lui n’ont d’autres amis que leurs camarades
de bouteille. Mais difficile de savoir par quel bar commencer, tant ils
pullulent dans cet endroit fangeux. On fait un rapide tour du quartier pour
voir celui d’où s’élèvent les clameurs et les cris les plus nombreux, les
odeurs les plus puissantes. Pas de doute, le «Jakarta» remporte haut la main ce
petit concours, et je suis le chef alors qu’il y rentre. Le sombre intérieur
ne reçois que peu de lumière de ses petites fenêtres aux carreaux brisés, et la
salle baigne dans la puanteur de l’alcool, du vomi, et du pétrole des lampes
qui brûle. Ce n’est que le matin, les clients peuvent donc encore entretenir
une conversation à peu près normale, semble-t-il. Les faces sont rouges et fermées,
les regards mauvais, et les âmes éloignées des attentions de Dieu.
Le chef s’assoit à une table où il reste encore de la
place, et alors que l’indignation des sacs à vins alentour allait éclater, il
clame d’une voix haute et claire: «Tournée générale pour moi, patron!». Et l’indignation
de ces visages burinés se transforme en un vif sourire de sympathie édenté. Alors que tous se
font servir, le manitou commence à questionner. Après la meilleur description
qu’on puisse donner de l’homme qu’il a fallu ramasser à la truelle sur le bord
de la route, nos questions commencent à trouver des réponses. Il venait très
occasionnellement dans ce bar, on le connaissait de vue, mais guère plus. Personne
à la table ne se considérait comme son ami, mais on entendit dire du fond de la
salle que peut-être quelqu’un serait en mesure de nous informer plus que cela. Manifestement,
on l’avait vu de temps en temps avec un homme étrange. Enfin, c’est ce que nous
comprîmes, car ici, personne ne peut vraiment être étrange. L’homme, donc, était
grand et bien sappé, avec un pardessus en gros cuir retourné et un borsalino. A
chaque fois une mallette avec lui. Ca avait fait jaser dans le milieu: un
respectable alcoolique avec cet homme, c’est inhabituel. Apparemment, ils se
rencontraient une fois par mois, et ça se passait toujours de la même manière. Le
grand attendait à la sortie du bar, et s’éloignait en silence avec lui. Personne
ne put nous en dire plus.
Alors que le chef jetait
sur le zinc sale une poignée de biffetons pour payer sa tournée, je jetais un
dernier coup d’oeil sur cette triste compagnie, dans ce bar putride. Qui se
souciait encore d’eux? Même Belzébuth semble les avoir oublié, et ils
pourrissent lentement, avachis au dessus de leurs verres, en attendant qu’il
veuille bien mettre fin à tout ce gâchis insensé. Le chef m’arrache à mes rêveries,
et nous sortons. D’un commun accord, nous décidons de retourner au central,
pour faire le bilan. Heureusement, la voiture est intacte! Le chef est bien
prudent de n’avoir que cette vieille caisse qui n’attire plus la moindre
attention, mais dans ce quartier, on ne peut jamais avoir de certitude. Le
Ringway nous permet de rejoindre le bureau, où nous retrouvons Cathryn en train
de ruminer. Depuis que le chef lui a demandé d’arrêter définitivement ses
reproches stupides, sans quoi ce serait mise à la porte, elle n’arrête plus de
grincer des dents et de ruminer ainsi. Peut-être finira-t-elle par partir,
comme Lynn l’avait fait avant elle. Mais le chef me fait entrer dans son
bureau, et ferme la porte derrière moi.
Nous n’avons pas d’informations
concrètes, mais que de points obscures. Ces marques sur le crâne du mort, ce
grand homme étrange, et personne qui ne puisse nous informer, même parmi ses
compagnons de beuverie. Le patron garde la tête froide, il dit que maintenant
notre seul contact pourrait être cet homme. On pourrait l’attendre devant le «Jakarta»
et l’interroger, mais il pourrait ne pas venir, et nous n’avons que 10 jours
avant que le corps soit inhumé. Mais dans une ville aussi peuplée que Lost-Paradise,
impossible d’espérer retrouver un homme que l’on a même jamais vu. Il faudrait
donc explorer des pistes, savoir qui il est. Son accoutrement n’est l’apanage d’aucun
gang connu, on peu même dire qu’il est tout à fait inhabituel. Ce n’est plus la
mode des cuirs depuis bien longtemps déjà. Il y a certainement dans cette ville
des boutiques spécialisées qui pourraient nous informer sur cet homme étrange,
car il a bien fallut qu’il se fournisse quelque part! On parcours le bottin à la
recherche de tailleurs. Jamais nous n’aurions pensé qu’il y en ait autant dans
cette ville! Tant pis, Cathryn se chargera de les appeler pour connaître précisément
leur activité, et demander s’il travaillent le cuir. Alors que nous quittons l’immeuble
sous les ruminements plus furieux que jamais de Cathryn, je me grille une clope.
Il fait froid, il est tard, la journée a été dégoûtante.
***
J’ai encore passé une
mauvaise nuit, hantée par des faces de cauchemars, des bouges immondes, des
corps sur la route, des légistes aux blouses ensanglantées... Mais on doit
continuer. Ce qui n’était qu’un simple accident de la route, un fait divers,
commence à prendre une dimension mystérieuse, et on se sent attiré par ces énigmes
sourdes qui hurlent dans l’obscurité. Je retrouve le patron au central, qui a
un air plutôt réjoui. Apparemment, Cathryn a bien travaillé, et la plupart des
tailleurs de la ville ont été rayés de notre liste. Il n’en reste plus que
trois: un certain Halligan, un Rosenblum, et un Krawford, ils sont les seuls a
accepter de faire des manteaux en cuir. Nous devons donc voir lequel de ces
tailleurs a bien pu confectionner le manteau du grand inconnu, et trouver son
identité. Le chef décide que l’on commencera par Rosenblum, le plus proche de
Mud River. La vieille Ford part dans un fracas de ferraille inquiétant, et nous
prenons la direction de l’échoppe. Le magasin est situé dans le quartier juif
de la ville, plutôt sûr, bien que grouillant d’activité. Nous sommes bien
accueilli par le petit homme au comptoir, caché derrière d’énormes lunettes. Nous
nous présentons, et lui expliquons les informations que nous recherchons. Il
reste à se gratter le crâne pendant plusieurs secondes sans nous répondre,
farfouillant dans sa mémoire. Il nous réponds finalement ne pas se souvenir
avoir confectionné un tel manteau, mais qu’il vérifiera dans ses registres
quand même. Nous lui laissons notre carte pour qu’il puisse rappeler s’il
retrouve cela. Le patron lui laisse un petit billet pour le remercier de sa
coopération, et nous filons vers l’établissement de Krawford.
Implanté dans le quartier
des classes moyennes d’anciens immigrés irlandais qui ont réussi à s’élever
socialement, la devanture verte ne manque pas d’attirer l’attention. C’est un
magasin de bonne taille, employant une dizaine de personnes. A l’accueil, nous
demandons à parler au patron, qui nous rejoins bien vite. Nous lui expliquons
notre histoire, et demandons son aide. Il répond qu’il n’est pas facile de
savoir tout ce qui est fabriqué ici, les demandes étant nombreuses, et il nous
conseille de voir les employés, peut-être se souviendront-ils d’un tel ouvrage.
C’est ce que nous faisons, mais sans obtenir de réponse, aucun ne se souvient
avoir réalisé chose pareille. Apparemment, notre homme n’est pas passé par ici.
Il ne reste guère plus que Halligan, qui n’est pas très loin. Lorsque nous
arrivons à l’adresse indiquée, nous trouvons la boutique fermée. Etrange, alors
que ce matin même on a répondu à Cathryn au téléphone. Pas d’horaires, pas de
mot, rien qui ne puisse nous indiquer si cette situation est normale ou non. Le
manitou décide de demander aux commerçants à proximité s’ils l’ont vu quitter
son magasin, et quand, vers où. Personne n’a vraiment fait attention, et d’ailleurs
personne ne le connaît vraiment. Halligan semble être un homme taciturne, et
personne ne comprends comment il arrive à vivre, les clients étant plus que
rares. Il va donc falloir tenter autre chose pour obtenir des réponses à nos
questions.
Mais le patron commence à s’énerver, il en a marre de
courir d’abord sur la trace d’un ivrogne, puis d’une grand inconnu, et enfin d’un
tailleur. Il veut décidément accélérer le dénouement de cette affaire qui ne
rapportera rien. On se faufile alors dans la cour de l’immeuble où est la
boutique de Halligan, et le patron fracture la porte arrière. Etrange de se
retrouver dans la situation d’un voleur sur le point de commettre son forfait. Le
petit dépôt dans lequel nous arrivons sert manifestement à entreposer les matières
premières, et quelques vieilles machines hors d’usage. Nous passons dans ce
qui semble être l’atelier, plutôt propre et bien ordonné, mais à l’odeur très
forte. Nous inspectons chaque meuble, chaque tiroir, pour trouver un registre,
une note de commande, ou quoi qui puisse nous mettre dans la voie.
C’est finalement moi qui
tombe sur un livre de compte, mentionnant un «pardessus taille 56, en cuir
retourné brun». En face, le nom de «J. Murdoch», et même l’adresse. Il semble
que l’on se rapproche de l’objectif. Le patron note tout cela, remet le livre
de compte à sa place, mais dérange quelques affaires et ouvre d’autres tiroirs
pour faire croire à un cambriolage. Puis nos sortons, et décidons unanimement
que nous poursuivrons l’enquête demain. Le patron me raccompagne chez moi et
repart dans ce soleil couchant d’hiver.
***
La nuit a encore été agitée,
mais pas de cauchemars cette fois. Dans mon rêve, nous poursuivions une
silhouette dans les rues de la ville, et juste au moment de l’attraper, je me
suis réveillé. Espérons que nous arriverons à mettre la main sur ce Murdoch, je
crois bien que la journée sera consacrée à ça. Par précaution, je mets dans la
chaussette un cran d’arrêt de bonne taille, et un derringer dans ma poche, c’est
discret mais ça peut sauver la vie. Quand j’arrive au bureau, j’apprends que le
patron a pris des dispositions similaires. On ne sait pas sur qui on va tomber,
ni ce qui se passait entre notre machabé et le grand homme au pardessus de cuir.
En cas de gros pépin, on a de toute façon un shotgun planqué sous la banquette
arrière de la Ford. Nous avons tous deux l’étrange pressentiment qu’il va se
passer quelque chose. C’est donc avec appréhension qu’on se rend à l’adresse
trouvée dans le livre de compte d’un tailleur lui-même pas clair. L’immeuble
est situé à la limite des anciens quartiers industriels qui ont fait faillite. Le
quartier est morne, la plupart des habitants ayant aussi déserté l’endroit pour
trouver du travail ailleurs. Nous ne savons pas à quel étage habite notre
homme, et bien évidement les boites aux lettres sont depuis longtemps démolies,
les noms illisibles. Nous procédons méthodiquement, appartement par
appartement, et jusqu’au troisième étage que des logements vides laissés la
porte béante. Mais au quatrième, une porte nous résiste. Qu’est ce qui peut
bien nous attendre derrière?
Le chef défonce la porte d’un
coup sec, et j’entre le premier, la main dans la poche prête à saisir mon arme à
tout moment. Au tout premier abord, il n’y a pas beaucoup de différence avec
les appartements abandonnés visités précédemment. Mais il n’y a pas de doute,
quelqu’un vit ici, au moins de temps en temps. Par on ne sait quel miracle, il
y a encore de l’eau au robinet, et de l’électricité, plus de téléphone par
contre. Mais concrètement, on ne trouve rien d’intéressant. Nous continuons
notre exploration de l’immeuble, quand on arrive finalement au septième et
dernier étage. De l’immeuble, seul l’appartement du troisième étage semble
habité et habitable. Alors qu’on se plonge dans nos pensées en descendant l’escalier,
un bruit nous parviens d’en bas. Quelqu’un est entré dans l’immeuble. Il va
falloir jouer la discrétion et l’attraper avant qu’il ne se rende compte que
son appartement a été forcé. Hélas, pas le temps d’arriver au troisième avant
lui, les marches grinceraient dans un vacarme qui nous ferait immédiatement
repérer. Je chuchote au patron qu’il vaut mieux attendre que l’homme entre chez
lui, et là nous pourrons lui parler. Il acquiesce d’un air dubitatif alors que
nous continuons notre descente. Nous pouvons voir l’homme prendre l’escalier,
et il porte bien un manteau brun. Nous n’avons plus guère de doute, et une
sorte d’instinct nous prépare à en découdre, d’une manière ou d’une autre.
L’homme arrive finalement à son appartement, nous sommes
alors entre le quatrième et cinquième étage, nous faisant tout petits pour ne
pas être vus. Il semble alors constater l’état de sa porte, parcours la
cage d’escalier des yeux, et fini par entrer chez lui. C’est le moment, nous
pressons le pas et arrivons à quelques mètres de sa porte. Brutalement, la
porte s’ouvre, et l’homme sort armé d’une terrible sulfateuse. Avant d’avoir
simplement eu le temps d’y penser, je me jette en avant, tout en saisissant mon
arme compacte. D’un coup rapide de l’avant-bras je détourne le canon de son
arme, et la rafale part dans le mur. Je lui pointe immédiatement mon derringer
sur le visage. Ce ne sont que deux cartouches de .32S&w, mais lui comme moi
savons que dans le crâne, la mort est assurée. Mais alors qu’il semble perdre
toute son énergie de combat, il m’envoie un violent coup de pied dans les parties.
Je m’écroule, naturellement, aveuglé de douleur. Je comprends juste que j’ai lâché
mon arme et que je suis au sol. Les bruit du combat entre mon patron et l’homme
m’arrivent toujours, mais sans plus rien vouloir dire, puis enfin se taisent. Je
reprends petit à petit mes esprits, même si la douleur ne s’affaiblit pas. Quand
je me lève, personne n’est autour de moi, mais le sol est maculé de quelques
taches de sang. Je me met finalement debout en m’aidant de la rampe, et m’avance
dans le fameux appartement.
Alors que j’entre dans le
salon, je trouve le patron avachi sous une fenêtre, se tenant l’abdomen une
crispation de douleur sur le visage. Il a du sang sur la main et sur la chemise.
Je me précipite vers lui pour examiner la blessure. Rien de très grave
apparemment, c’est juste une mauvaise blessure de couteau, longue mais peu
profonde, sauf que dans le gras, c’est douloureux. Il me fait signe d’une
hochement de tête de regarder par la fenêtre. En bas, l’homme gît dans une
marre de sang. Il semble remuer encore, et je le signale au patron. Il me dit
les dents serrées d’aller voir, qu’il peut se débrouiller seul. Je sais qu’il
se connaît, je sort et descend en trombe les escaliers, franchis le seuil, et
m’approche de l’individu. Je ne m’étais pas rendu compte, mais c’est vrai qu’il
est grand, il doit bien faire 1m90. Je m’approche prudemment, car il pourrait être
encore armé. Mais à le voir gesticuler ainsi, il est bien trop brisé pour
pouvoir se défendre. Il a l’air solide, et vivra sans problème, même s’il n’est
ramené à l’hôpital que dans plusieurs heures. Je saisis mon cran d’arrêt qui n’avait
pas quitté ma chaussette, lui plaque sur la gorge et commence à l’interroger.
Il confirme qu’il s’appelle
bien Murdoch, John Murdoch, et qu’il a voulu sciemment nous tuer. Il pensait
que nous étions des vagabonds venus lui prendre ses économies ou l’assassiner
chez lui. Ce pourrait être vrai, mais j’en doute un peu, ce quartier est trop
abandonné pour que l’on puisse croire que quiconque viendrait y faire ses larcins.
Alors que je lui demande d’avouer quelle était sa véritable raison de vouloir
nous plomber, j’entends un bruit derrière moi, qui se rapproche. Je fais
semblant de ne pas réagir, et presse Murdoch, tout en assurant la prise de mon
couteau. Quand le bruit n’est plus qu’à un mètre de moi, je fais volte-face et
entame un mouvement pour poignarder mon agresseur. Mais mon bras est arrêté dans
sa course par le canon du fusil que tiens le patron, et qui ne s’attendait sûrement
pas à être assassiné par son propre associé. La première surprise passée, nous
nous expliquons. Alors que je questionnais le défenestré, le patron est allé chercher
le fusil pour s’en servir de béquille, et éventuellement pousser Murdoch à la
coopération. C’est un coup de chance qu’il ait levé l’arme et arrêté mon coup,
qui sinon l’aurait touché en pleine carotide, et c’en était fini de lui. Il
doit avoir une bonne étoile qui a décidé que ce n’était pas son heure.
Murdoch continue à agiter pitoyablement ses bras brisés en
nous invectivant, nous rappelant que c’est à lui que nous devons nous intéresser.
Il a instinctivement compris la manière dont ça se passerait: il
raconte tout ce qu’on veut savoir, en remerciement de quoi on l’amène à l’hôpital.
Il sait très bien que si ses réponses ne nous plaisent pas, on le laissera gésir
là, et pour toute compagnie il aura les chiens qui viendront laper son sang. Frappé
de cette image biblique, il décide de se mettre à table. Notre accidenté de la
route s’appelait Steven Koll, il était un alcoolique invétéré depuis des années.
Il refusa encore de nous dire pourquoi il le rencontrait chaque mois, mais nous
expliquât qu’il nous avait tiré dessus car il savait qu’on enquêtait sur lui. Il
avait été averti par le tailleur, qui s’était empressé de lui rendre visite
pour lui signaler qu’on le cherchait, juste après l’appel de Cathryn, ce qui
expliquait qu’il n’y avait personne lors de notre visite. Il craignait les
poursuites et les enquêtes car s’était un ancien taulard qui s’était alors mis à
dos un ponte local, et il pensait qu’il le cherchait toujours pour lui régler
son compte. Il s’était acquis la sympathie du tailleur en lui faisant la
commande de ce manteau si coûteux, qu’il avait largement payé avec l’argent
caché des ses vols. Mais il refusait toujours de nous en dire plus sur Koll,
alors voyant qu’on obtiendrait rien de plus de lui, on l’amené malgré tout à l’hôpital.
Il avait été honnête avec nous, et nous ne sommes pas des hommes à laisser
agoniser une personne dans son sang, même si nous arrivons à le faire croire.
***
Je me réveille avec cette
terrible douleur entre les jambes. Le salaud! On aurait du le laisser crever là,
sur son trottoir, finalement! Mon petit meublé est encore plus sombre qu’à l’accoutumée,
ou du moins me parait tel. Avec les mauvaises aventures d’hier, je vais jouer
la précaution, quoi qu’il arrive. Dans le coin de la chambre, le coffre
contient la prunelle de mes yeux, mon adorée, mon bébé. Elle s’appelle Ingrid,
elle est venu au monde en 1915, marquages de l’armurerie de Springfield faisant
foi. Elle m’a accompagné dans les tranchées, alors que je n’avais fêté ma
majorité que depuis trois semaines. Elle se nourrit de munitions de .45ACP, et
j’ai choisi pour elle les meilleures, celles à tête creuse et poudre non-corrosive.
Je l’ai habillée de plaquettes de crosse en ivoire, gravées à nos deux
initiales, et lui ait offert un écrin sur mesure, rembourré de velours bleu
nuit. Quand je l’emporte avec moi, je la met toujours dans son holster d’épaule
fait sur mesure, pour la protéger. Et trois chargeurs pleins dans un étui de
ceinture permettent d’affronter les situations les plus gourmandes en plomb, me
donnant un total de 36 coups à tirer. A partir de maintenant, elle me suivra
partout, comme au bon vieux temps, et son pouvoir de destruction massive nous
protégera de nos ennemis.
Quand j’arrive au central, Cathryn m’accueille comme à son
habitude, et je rejoins immédiatement le bureau du patron. Il m’attendais en
fumant à la fenêtre, le regard dans le vague; c’est notable, car il n’est pas
souvent dans cet état là. S’apercevant de ma présence, il tire une dernière
bouffée et jette son mégot. Quand il relève les yeux sur moi, il a sur le
visage son expression des grands jours, il n’a certainement pas beaucoup dormi.
«Petit, me dit-il, encore que je sois le plus grand, le nom de l’accidenté que
nous a donné le défenestré me disait quelque chose. J’étais certain de l’avoir
déjà lu, alors j’ai mené de petites recherches cette nuit. J’ai parcouru les
bottins et les journaux, tout d’abord sans rien trouver. Puis en désespoir de
cause, éreinté par ces recherches infructueuses, je m’assoupissais dans mon
fauteuil. C’est alors que je fis un rêve étrange: j’étais assis dans mon
fauteuil, en train de chercher, mais sans trouver non plus. Au bout d’un
moment, dans mon rêve, je prenais un café, exactement comme je l’avais fait
plusieurs fois dans la soirée, et reposais la tasse sur la table, et c’est
alors que...» et il brandit devant mon visage une coupure de journal,
superbement ornée d’une auréole laissée par une tasse de
café, tirée de la rubrique nécrologie, et qui annonçait la mort de monsieur
Steven Koll. J’étais pétrifié par cela, car personne n’était censé connaître sa
mort, ou personne qui ne connaisse son nom en tout cas, excepté Murdoch mais il
n’avait certainement pas la tête et le moyen pour prévenir un journal.
Quand le patron me sortit
le journal dont était tiré l’article, j’en tombais à bout de souffle sur la
chaise qui se trouvait derrière moi. Il datait précisément du soir où nous
avions découvert le corps. Impossible! A part l’automobiliste qui nous a
signalé le corps, personne n’aurai pu nous «doubler». Le patron semblait lire
sur mon visage mes pensées, et me regardait d’un air entendu. Mais je
poursuivait mon raisonnement. Si on avait déclaré la mort de cet homme, sans
avertir la police ou les secours, c’est qu’il y avait quelque chose de louche. Soit
une personne l’ayant connu lui a roulé dessus et s’est arrêté pour voir ce qu’il
en était, mais n’a pas voulu prévenir les secours ou la police pour éviter d’avoir
à étaler ses liens avec cet alcoolique, ce qui est envisageable, mais dans ce
cas, pourquoi le signaler à un journal? Qui se soucie de la mort d’un ivrogne?
C’était trop étrange. La seule solution qu’il reste, c’est que ce Koll était un
homme à abattre, et qu’il fallait que sa disparition soit su sans que les
autorités en soient alertées, ou alors le plus tard possible. Et tout
correspondrait: ces traces derrière la tête, cette mort étrange si loin de la
ville qu’il fréquentait, le refus de Murdoch, lui-même recherché, de parler. Mais
avant de s’emporter dans les brumes du doute et de l’hypothèse, il nous faut
des preuves, ou des témoignages. Mais nous avons remplie la plus grande partie
de notre mission: trouver un nom à ce visage atroce étalé sur la route, et en
informer ceux qui le connaissaient.
Comme nous n’avons aucun
moyen de vérifier la thèse du proche qui l’aurait reconnu après l’accident,
nous nous penchons vers la thèse de l’assassinat, en espérant malgré tout que
ce ne soit pas ça. En toute logique, on ne pourra aller trouver d’information
qu’auprès de deux personnes: Murdoch, et le journal qui a publié l’annonce de
la mort. Malheureusement, Murdoch est dans un sale état, et il lui faudra un
certain temps avant de pouvoir parler sereinement. Le patron décide donc de se
rendre directement au journal, le Lost Paradise Tribune. Ce n’est pas très
loin, nous y allons donc à pied. Le hall d’entrée est assez magnifique, il faut
l’avouer, mais ce n’est pas étonnant pour le deuxième journal de la ville, et
au comptoir une hôtesse au grand sourire nous appelle à elle par de furieux
clins d’oeil. Le patron s’approche, nous présente, et demande où il est
possible de rencontrer les personnes responsables de la rubrique nécrologique. Apparemment,
la jeune femme ne s’attendais pas à cela, et son sourire se crispe légèrement,
il semble bien qu’elle ne sache pas trop quoi répondre. Mais une autre hôtesse
qui devait être à l’arrière nous ayant entendu nous lance d’un ton lapidaire: «Troisième
étage, porte 7.». On comprend mieux pourquoi elles sont deux: une qui sait, et
une qui sourit. Je suis le chef qui se dirige vers l’ascenseur, et nous
descendons, comme indiqué, au troisième étage. Derrière la porte 7, un petit
office de quelques bureaux, et pas plus de trois personnes. Le patron s’avance
vers celui qui semble le plus affairé, et nous présente. Le petit homme chauve
ne réagit pas. Nous nous raclons la gorge de concert, mais sans plus d’effet. Le
patron fait alors mine de sortir, mais actionne l’interrupteur. Plongé dans la
pénombre, le petit homme relève la tête et prête enfin attention à nous. Une
fois la lumière revenue, nous nous présentons encore une fois.
Nous revenons au central sans avoir rien appris. Personne
au Lost Paradise Tribune ne se souvient de cet avis de décès, ce genre de chose
étant trop négligeable pour que quiconque s’y intéresse. Le petit
chauve nous a expliqué qu’il n’a fait que retranscrire une note qui était sur
sa table, et que personne ne semblait avoir mis là. Nous n’avons plus guère
espoir de trouver une piste avant que Murdoch se remette un minimum de sa
chute. Mais il y a pourtant bien quelque chose que l’on puisse faire! On ne va
pas rester les bras croisés, m’insurge-je à haute voix. Le patron, d’un nature
plus patiente, hausse les épaules. Mais une idée me traverse la tête. S’il y a
meurtre, comme on en a conservé l’hypothèse, il y a arme! Il faut retourner
voir le corps, savoir si on peut identifier ce qu’on va devoir chercher. Le
patron me regarde d’un air étonné, il semble qu’il n’y ait pas pensé. Il faut
dire qu’il est plus tenté par l’argent que rapporte une affaire que par la
punition des criminels et le rétablissement de la vérité. Nous filons donc à la
morgue, et trouvons le légiste. A l’annonce de nos doutes, il prend un air
ahuri. Il savait déjà que le mort s’appelait Steven Koll, puisque quelqu’un
est venu identifier le corps, et a décidé de s’en occuper, une entreprise de
pompes funèbres étant venu embarquer le corps la veille. Ouch! Il semble bien
qu’on ait affaire à forte partie, si c’est une organisation criminelle. Mais le
légiste semble rire sous cape, et nous explique que c’est une dame assez chic
qui est venu, et pas un des molosses de la mafia. Nous allons vérifier nous-même.
Evidement, on ne peut pas
emporter un cadavre comme ça, il faut signer quantité de papiers et de
formulaires, et cette fois-ci n’a pas échappé à la règle. On apprend donc que
Johnson&Johnson est venu chercher le corps, avec l’adresse et le téléphone
de l’entreprise. Nous traversons toute la ville et arrivons enfin au petit
magasin situé dans les anciens quartiers. L’homme sombre au teint pâle qui nous
reçoit ne semble pas très causant, et fait passer «la confidentialité et la
discrétion garantie à ses clients» avant le devoir d’aide à notre enquête. Mais
le chef ne l’entends pas de cette oreille là. Il a une piste, et ce n’est pas
ce misérable employé blafard qui se mettra en travers de sa route. Mais le
croque-mort ne semble pas de caractère à céder, et le ton monte. Je décide d’intervenir,
et dégaine Ingrid. Evidement, le pâle personnage se calme immédiatement. Lui
qui a enterré tant de personne, il n’aimerait pas qu’on l’enterre avant l’heure,
et il a l’expérience des résultats de la balistique sur les tissus mous. C’est
en traînant les pieds qu’il nous emmène dans la chambre froide où il conserve
les corps en attente. Koll est là, rien qu’à l’odeur nous le sentons en
entrant, et le croque-mort lui-même semble indisposé. Il nous explique qu’il
devra tout laver après, et que ça lui fera encore du travail supplémentaire. Ayant
commencé à ouvrir sa bouche, il semble qu’il ait des difficultés à la fermer
maintenant, et exprime son étonnement quand au fait que quelqu’un ait décidé de
prendre en charge ce corps, en plus un «client très bien», ajoute-t-il.
Nous examinons l’arrière du crâne, et retrouvons les
fameuses marques dont nous avait parlé le légiste. Ca ressemble à des
empreintes de livre, aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est en tout cas
quelque chose d’étroit et long, assez lourd. Nous ne voyons pas trop ce que ce
pourrait être, mais le croque-mort vient nous prêter main forte. Pour lui, pas
d’erreur, c’est un coup de crosse de pistolet. Il tire Ingrid de l’étui sans me
demander la permission, et applique le talon de l’arme sur le cou du mort. Pas
de doute possible, c’est bien cela. Je reprends précipitamment mon arme, et l’essuie
avant de la rengainer. Il semble bien que la thèse de l’assassinat soit la
seule qui puisse tenir, maintenant. Mais le corps sera bientôt inhumé, et le
croque-mort nous explique qu’en aucun cas il ne peut laisser s’ébruiter qu’il n’a
pas respecté «la confidentialité et la discrétion», donc pas de possibilité de
constater les marques. Ca va être une gageure: retrouver les preuves
indiscutables du meurtre sans le corps. Mais un énorme problème subsiste: qui
prends en charge le cadavre? Le patron et moi semblons penser la même chose au même moment, et nous
tournons vers le maître des lieux. Il refuse de nous communiquer le nom ou l’adresse
de son client, c’est un principe de la maison. Cette fois-ci, rien n’y fera, il
ne cédera pas, et nous quittons le sinistre endroit en soupirant. La journée
ayant été suffisamment fatigante, nous décidons de nous quitter. Les morts et
les vivants pourront attendre jusqu’à demain, qu’on trouve un sens à tout cela.
***
J’ai étonnamment bien
dormi, par rapport à la journée que nous avons passé hier. Une fois dans le
bureau du patron, nous commençons à nous creuser la tête pour savoir où, et
quoi, chercher maintenant. La voie qui s’ouvrait à nous, pleine de promesse, a été
brutalement refermée par le secret professionnel inébranlable de notre dernier
interlocuteur. Alors que nous tournons en rond en cherchant la solution à notre
intrigue, Cathryn entre l’air timide. «De mon bureau, j’ai entendu votre
conversation, dit-elle, et sans vouloir vous apprendre votre métier, il me
semble bien facile de retrouver le commanditaire de l’enterrement». Nous la
fixons tous deux, partagés entre un profond scepticisme et un grand espoir. «Il
sera très certainement à l’enterrement». Et la révélation nous tombe au coin de
la tronche: notre secrétaire a plus de bon sens que nos deux cerveaux réunis. Le
patron, rouge de honte, l’invite à retourner à sa paperasse, et à nous laisser
réfléchir à cela. Après avoir récupéré de cette humiliation cuisante, nous
commençons à raisonner: l’enterrement est à une date connue de nous, dans deux
jours, nous avons donc amplement le temps de nous préparer à cette rencontre. La
question sera de savoir comment approcher la personne. En principe, elle ne
nous connaît pas, il ne devrait pas y avoir de problème, mais si elle est
accompagnée, ou si elle fuit, il faut prévoir des plans de secours. A la fin de
la journée, nos têtes, devenues lourdes et douloureuses, nous rappellent à l’ordre,
et le patron me raccompagne à mon petit appartement dans sa vieille Ford
cahotante.
***
Nous passons la journée du
lendemain à ne rien faire, si ce n’est ressasser les éléments de l’enquête, et
refaire le point sur les plans que nous avons prévus pour rencontrer «le commanditaire».
Cette personne, apparemment riche, et suffisamment importante pour vouloir
conserver l’anonymat, devrait pouvoir nous en apprendre plus, et faire avancer
cette affaire qui commence vraiment à devenir incompréhensible. On retrouve un
clochard écrasé sur la route, on nous demande de retrouver ses proches pour
faire identifier le corps, ce qui nous mènes aux bas-fonds de la ville. On y
apprends qu’il avait un contact avec un inconnu étrangement habillé. On
retrouve le tailleur, et par effraction nous découvrons l’adresse du «contact»,
qui vit dans le no man’s land de la friche industrielle. Tombant sur lui à l’improviste,
nous risquons de nous faire tuer, mais à la suite de la fusillade il chute par
la fenêtre. Je le retrouve en bas, et manque de poignarder le patron. Il nous
crache le morceau: le nom du clochard. Alors que nous suspectons que notre
accidenté ne l’est peut-être pas tellement que cela, nous apprenons que le
corps a été retiré de la morgue. Nous rendant à l’office de pompes funèbres,
nous recevons la confirmation du meurtre. Et nous y voilà, à devoir retrouver, à
l’enterrement, la personne qui a payé ses obsèques.
***
Aujourd’hui: le grand jour.
Enfin, il ne devrait rien se passer d’extraordinaire, mais du fait que ce soit
notre dernière piste, et que ça fait deux jours qu’on attend ce moment, on appréhende
cette rencontre. C’est aujourd’hui un triste vendredi matin, et le crachin
assombri le marbre des tombes. Nous nous sommes posté à l’entrée du cimetière,
et attendons maintenant que le corbillard passe. Il est suivi de deux voitures
noires aux vitres fumées. Ce genre de voiture fait parfois parti de la
prestation pour l’enterrement, mais il ne serait pas étonnant que ce soit plutôt
la propriété de notre mystérieux commanditaire. Nous suivons de loin le cortège
funèbre, et nous arrêtons en même temps qu’eux, et finissons notre approche à pieds.
Dès que les visages sont reconnaissables, le patron prends des photos, ça
pourrait servir plus tard. Après quelques dizaines de minutes de recueillement,
nous nous approchons. Le groupe est formé d’une belle femme en pleurs,
accompagnée de près par une sorte de nabot binoclard et d’une dame de compagnie,
et cinq gorilles à l’air particulièrement patibulaire qui se tiennent en
retrait. A vrai dire, nous nous attendions à quelque chose comme cela, et tout
est prévu.
Sur un signal, Cathryn
sort de la Ford du chef et nous rejoint. Chacun de nous lui prend un bras, et
nous faisons mine de rejoindre ostensiblement la tombe. Le cimetière est désert,
et notre mouvement ne manque pas d’être remarqué. Le nabot chuchote à l’oreille
de la dame, qui tourne la tête pour nous regarder. On peut lire sur son visage
l’étonnement se rajouter à l’affliction, et ses pensées se bousculer dans sa tête.
Elle semble hésiter, puis vient à notre rencontre, suivit de près par ses
gardes du corps. Nous avons fait semblant jusqu’à présent de ne pas porter
notre attention sur elle, mais maintenant, à une telle distance, il ne s’agit
plus de faire semblant, aussi sommes nous profondément surpris quand la dame se
précipite, furibonde, sur Cathryn et lui met une claque. Pendant un instant,
nous restons paralysés de cet acte, et les gorilles aussi, mais très vite, tous
tentent de séparer les deux femmes. Une fois le calme revenu, les «explications»
commencent.
Elle se présente,
manifestement sous un faux nom, Iris Glencut, s’excuse très vaguement, mais
reprend sa charge verbalement. Elle prétend que Cathryn, qu’elle n’a jamais vu,
c’est certain, a un sacré culot de venir ici maintenant, et que si elle n’avait
pas à se cacher, elle aurait payé ce geste. Mais petit à petit, sa colère
baisse, et le chagrin du décès, et la honte de ce comportement commence à refaire
surface. Les gardes du corps se sont écartés, et fument dans un coin, nous
ayant considéré comme inoffensifs, et de toute manière ils semblent assez peu
habitués à protéger cette patronne. Elle finit par s’asseoir sur une tombe,
effondrée. Cathryn, touchée par cette femme, se met à coté d’elle et commence a
essayer de la réconforter, et nous assistons impuissant à la pathétique scène. Puis
peu à peu, Iris commence à parler.
«Je sais qui vous êtes, et je crois que je peux vous faire
confiance. Je ne peux plus supporter ce fardeau, je vais vous révéler toute
notre histoire. Je m’appelle en réalité Mary Porter, et je suis la femme du
baron de la pègre, Luigi Vercotti. Pendant son premier emprisonnement, il a
connu Steven Koll, celui que je pleure aujourd’hui, et il lui avait fait
excellente impression. Aussi, quand mon mari sortit de prison, il dit à Steven
qu’il aurait toujours une place pour lui. Quand Steven fut libéré à son tour,
il alla donc voir mon mari, qui lui proposa un poste de majordome, qu’il
accepta. Mais comme mon mari était toujours ailleurs, pour ses affaires, je
restait souvent seule dans notre résidence, et Steven était mon principal
interlocuteur. Il était agréable, mais surtout attentif avec moi, tout ce que n’était
pas mon mari. Assez vite, je me pris de passion pour cet homme, avec qui je
discutait pendant des heures.»
«Mais je savais cette
liaison impossible, aussi mon esprit avait toujours le dernier mot sur mon
coeur, même s’il m’en coûtait des larmes.»
«Mais un bel après-midi de
printemps, alors que nous buvions le thé sous la pergola, l’air était frais, le
soleil perçait au travers de la végétation reprenant vie, Steven m’avoua sa
flamme. En un instant, mon esprit se troubla, mon coeur s’embrasa, et je succombait
à cet amour interdit. Nous nous aimions de tout notre être, mais nous devions
faire semblant quand Luigi était là. Mais à la suite d’un accident, il dut
rester longtemps à la maison. Mais nous ne pouvions renoncer à nous voir,
Steven et moi, pendant le temps que mon mari serait là, et nous élaborions sans
cesse des plans de plus en plus compliqués, pour se voir de plus en plus
longtemps. Mais Luigi, qui a la jalousie et la suspicion dans le sang, commençait
à suspecter quelque chose. Il nous fit surveiller, et me retenait autant qu’il
pouvait pour voir si je résistait. Mais il eu en assez peu de temps la
certitude que je lui était infidèle. Dans un premier temps, il renvoya Steven,
et lui et moi étions bien trop passionnés pour pouvoir essayer d’empêcher ce
licenciement d’une manière qui ne nous trahissait pas. Mais malgré mon
isolement, nous trouvâmes tout de même moyen de nous voir. Luigi, apprenant
cela de ses sbires qui m’épiaient nuit et jour, entra en rage, et il fit
renforcer la sécurité de la résidence, m’enfermant dans une prison dorée que même
notre amour ne pouvait forcer.»
«Mais Steven n’était pas
un homme sans ressources, et par un de ses amis de prison, John Murdoch, celui
que vous avez envoyé à l’hôpital, nous avons réussi à correspondre malgré tout.
Pendant quelques années, nous avons pu continuer ainsi, mais chacun de notre
coté, nous dépérissions. Les lettres étaient bien insuffisantes, quelle que
puisse être leur longueur. Steven sombra dans l’alcoolisme, et ma santé était déclinante,
je perdais toute joie de vivre. Mon mari, me voyant dans cet état, me fit faire
une cure en montagne, il y a plusieurs semaines de cela. Je résistais avec les
quelques forces qui me restait, mais je ne voulais pas lui faire suspecter que
je pouvais encore avoir la moindre relation avec Steven. Je n’était pas ici
quand la suite des évènements est arrivé, mais je crois parfaitement savoir ce
qui s’est passé. Steven, ne recevant plus de nouvelle de moi, tomba dans un désespoir
encore plus grand, et alla peut-être même imaginer que les plus grands malheurs
m’étaient arrivés. Il quitta la ville, qui avait été le cadre de notre passion
tragique. Dans le même temps, je suppose que Luigi, en fouillant mes affaires,
a réussi à mettre la main sur notre correspondance. La folie s’empara de lui,
et il ordonna que Steven soit retrouvé et tué.»
«Puis je revins a Lost
Paradise, et Murdoch me fit savoir qu’il ne retrouvait plus Steven. Prise de désespoir,
je croyait qu’il avait trouvé une autre femme, qui aurait pu lui donner mieux
que cet amour à distance. Et les sbires de Luigi parcouraient toujours la ville
à la recherche de Steven, ratissant chaque rue, chaque bar. Mais il était déjà loin,
emporté par le chagrin, me croyant morte ou perdue à jamais. Et finalement, les
sbires de mon mari le retrouvèrent. Murdoch réussi à entendre dans les
discutions des hommes de main que le travail avait été effectué. Il savait
malheureusement de quoi il s’agissait, et en informa un journal. Et c’est ainsi
que j’ai appris la mort de mon amour. Vous savez la suite, je me suis chargé de
lui offrir des obsèques décentes, c’est le moins que je puisse faire, moi qui n’ai
pas su lui faire partager ma vie et mon amour... pour toujours.»
Et là, sous cette petite pluie, comme des larmes céleste,
assise sur le marbre, ses mains dans les nôtres, elle alla rejoindre le seul qu’elle
ait jamais aimé.